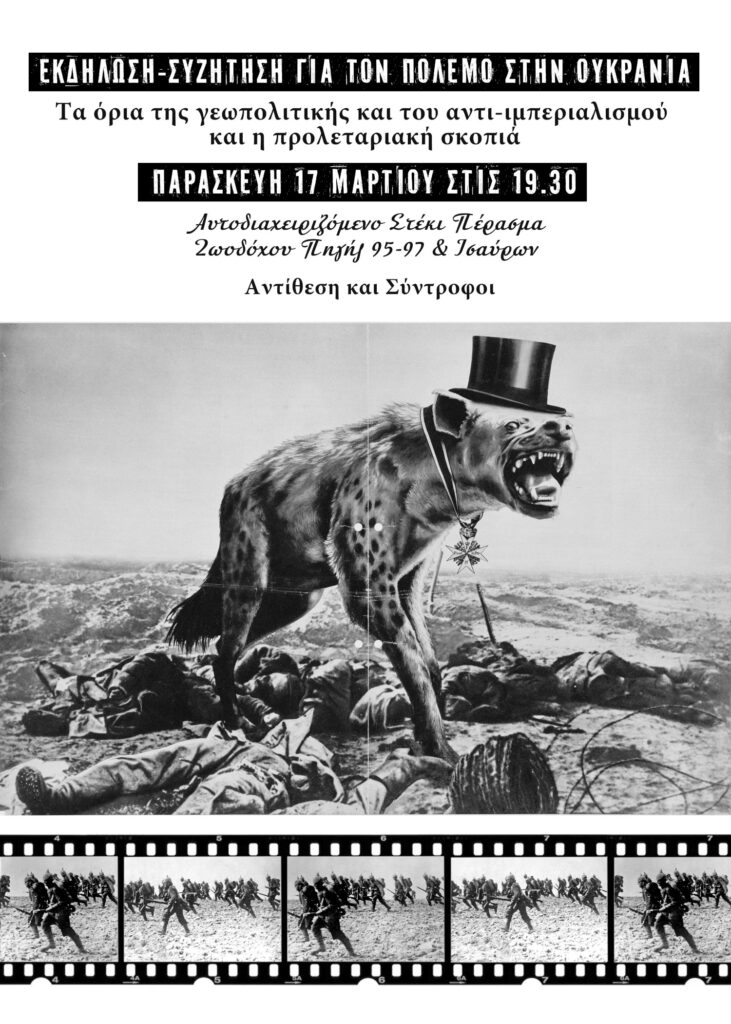[Ce texte sera publié en grec dans le premier numéro d’un nouveau magazine d’ici fin 2017.]
À propos de l’écologie du capitalisme [Download pdf]
« Le développement de la production s’est entièrement vérifié jusqu’ici en tant qu’accomplissement de l’économie politique : développement de la misère qui a envahi et abîmé le milieu même de la vie […] Dans la société de l’économie surdéveloppée, tout est entré dans la sphère des biens économiques, même l’eau des sources et l’air des villes, c’est-à-dire que toit est devenu le mal économique, ‘reniement achevé de l’homme’… »
Guy Debord, La planète malade, Gallimard 1971, page 85.
Le processus d’expansion du mode de production capitaliste à une échelle mondiale au cours du siècle écoulé a été, en même temps, un processus de transformation de la biosphère dans son ensemble. Ce processus a eu pour conséquence de bouleverser l’équilibre écologique de la planète, équilibre qui s’était maintenu depuis 10 000 ans, période géologique connue sous le nom d’Holocène. Selon des études scientifiques récentes, les principaux aspects de cette transformation écologique planétaire sont les suivants[1] :
- Augmentation de la température moyenne de la planète due à une concentration accrue de gaz carbonique et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Cet accroissement résulte à la fois de la combustion des carburants fossiles qui fournissent son énergie à la production et à la reproduction capitaliste, ainsi que des émissions dont l’origine est le mode de production agricole capitaliste.[2]
- Énorme perte de biodiversité, due, principalement, à la conversion d’écosystèmes forestiers en zones de production agricole ou en tissu urbain. Certains prédisent que d’ici la fin du XXIe siècle, jusqu’à 30% de tous les mammifères, des oiseaux et des amphibiens seront menacés d’extinction.
- Perturbation des cycles de l’azote et du phosphore, dont les taux de plus en plus élevés passent dans l’atmosphère, dans les océans et dans les lacs de la planète ; cette perturbation est due à l’utilisation massive d’engrais par l’agriculture capitaliste. La pollution des océans a même entraîné des épisodes anoxiques localisés (par exemple dans la mer Baltique) au cours desquels les niveaux d’oxygène dans la mer baissaient de manière significative.
- Outre les phénomènes décrits ci-dessus, la diminution de l’ozone atmosphérique et le niveau d’acidification des océans ont atteint un seuil critique.
À une échelle géographique plus localisée, toutes ces évolutions environnementales se manifestent donc de plusieurs manières : accroissement considérable de la fréquence des ouragans, désertification de vastes territoires dans plusieurs parties du monde, déforestation, augmentation de la fréquence de phénomènes climatiques extrêmes telles les inondations et les sécheresses de longue durée, émergence de nouvelles maladies qui se transmettent de manière imprévisible, etc. En même temps, la productivité de l’agriculture s’est considérablement ralentie à cause de l’épuisement des sols. En outre, les nouvelles méthodes de culture biotechnologiques basées sur les plantes génétiquement modifiées n’ont pas réussi à inverser cette tendance en raison de l’apparition de ce que l’on appelle les « mauvaises herbes super résistantes ». Entre 1980 et 2008, la production mondiale de blé et de maïs a été réduite de respectivement 5,5% et 3,8% si on la compare à une analyse contrefactuelle ne faisant pas état des tendances climatiques.[3] Ces phénomènes ont des effets négatifs sur les conditions de vie du prolétariat mondial. Les fractions les plus faibles et les plus pauvres du prolétariat sont affectées de manière disproportionnée car elles doivent affronter jusqu’à des pénuries de nourriture et d’eau potable.
Selon l’idéologie apologétique qui caractérise l’ « économie environnementale », l’accumulation de polluants et de substances toxiques, c’est-à-dire la destruction des conditions naturelles requises pour la satisfaction des besoins humains, résulte d’un conflit inhérent entre l’humanité et la nature extérieure à l’homme.[4] On ne veut pas voir que ces transformations ont le mode de production capitaliste pour origine. Les natures extérieures à l’homme, c’est-à-dire les conditions naturelles et les ressources que la production capitaliste ne peut (re)produire, sont considérées comme des « dons de la nature » usurpés par les capitalistes sans qu’ils en paient le prix. Lorsque la dégradation de l’environnement fait obstacle à la reproduction élargie du capital parce qu’elle entraîne, par exemple, soit un ralentissement de la productivité agricole, soit un accroissement des dépenses pour combattre les maladies liées à la pollution et, par conséquent, à une augmentation de la valeur de la force de travail, on qualifie les phénomènes de dégradation de l’environnement d’ « externalités environnementales » ou d’ « économies externes ».[5]
Avant de procéder à une critique plus détaillée des « solutions » proposées par « l’économie environnementale », qui tournent surtout autour de la monétarisation de la nature, c’est-à-dire l’ « internalisation » des ressources et des conditions naturelles dans le marché capitaliste, nous tenterons, à l’aide des outils de la critique marxienne de l’économie politique, de montrer pourquoi la domination du mode de production capitaliste est intimement liée à la dévalorisation permanente à la fois de la nature humaine et de la nature extérieure à l’homme. Dans la dernière partie du texte, nous essaierons de présenter une critique de certains aspects des luttes sociales qui se sont dressées contre la dévalorisation de la nature et de faire preuve d’esprit critique envers les idéologies qui sont apparues et ont fait obstacle à leur développement.
1 – La loi de la valeur et la nature en tant que non-valeur.
« Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l’homme et la nature, un acte dans lequel l’homme harmonise, règle et contrôle, par sa propre action, ses échanges organiques avec la nature. »
K. Marx, Le Capital.[6]
« Le travail n’est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant la source des valeurs d’usage (et c’est bien en cela que consiste la richesse matérielle !) que le travail, qui n’est lui-même que la manifestation d’une force matérielle, de la force de travail humaine. » K. Marx.[7]
La production capitaliste des marchandises repose à la fois sur le travail humain et sur la nature. Cependant, la valeur des marchandises n’est déterminée que par le temps de travail abstrait socialement nécessaire que requiert leur production. L’expression en argent de la valeur sociale, qui est la forme sous laquelle apparaît nécessairement le travail abstrait, entraîne à cet égard la dévalorisation de la nature non-humaine.[8] Et cette dévalorisation n’est rien d’autre qu’une expression de la contradiction entre la valeur d’usage et la valeur qui se dissimule sous la forme de la marchandise. Comme Marx l’a écrit dans Le Capital, « comme valeur d’échange [les marchandises] ne contiennent pas un atome de valeur d’usage » et, par conséquent, pas un atome de nature non-humaine.[9]
Le caractère homogène, divisible, mobile et quantitativement illimité de la forme de la valeur est en opposition directe avec la diversité qualitative, la spécificité locale, les limites quantitatives, et le caractère unitaire et indivisible des valeurs d’usage produites par la nature. « La contradiction entre la nature particulière de la marchandise (produit) et sa nature générale (valeur d’échange) fait nécessairement qu’elle existe sous une double forme : marchandise déterminée d’une part, et argent d’autre part. D’emblée la contradiction entre les propriétés naturelles spécifiques et les propriétés générales et sociales fait que ces deux formes d’existence peuvent ne pas se convertir l’une dans l’autre. »[10]
En outre, la tendance du capital à une expansion illimitée et continue en tant que valeur auto valorisante entre en conflit avec les conditions matérielles et éphémères déterminées par la nature qu’exige la production (surtout) agricole, c’est-à-dire les cycles de reproduction biologiques des animaux et des végétaux. Ce conflit concerne particulièrement le besoin qu’a le capital de réduire sans cesse son temps de rotation (c’est-à-dire la somme de son temps de production et de son temps de circulation) de telle sorte que la valeur et la plus-value produites au cours d’une année du cycle économique soit multipliée. Cette « compression du temps-espace », comme l’a appelée David Harvey[11], a donné lieu à une accélération à la fois bizarre et terrifiante de la production de la nature : pêcheries produisant des saumons transgéniques à croissance rapide, vaches bourrées d’hormones produisant leur lait plus précocement et, plus spectaculaire encore, le passage du poulet de 73 jours en 1955 à celui de 42 jours en 2005[12].
2 – La dissociation de la société et de la nature.
Comme Marx le démontre clairement dans Les théories sur la plus-value, la valeur de production dans le capitalisme sous-entend l’aliénation du travail :
« Le capital n’est production de valeur que comme rapport, dans la mesure où, contrainte du travail salarié, il contraint celui-ci à fournir du surtravail ou encore stimule la force productive du travail, afin de créer de la plus-value relative. Dans un cas comme dans l’autre, il ne produit de la valeur que comme pouvoir sur le travail, devenu étranger à ce travail, des conditions objectives propres de celui-ci, somme toute uniquement comme une des formes du travail salarié lui-même, comme condition du travail salarié. Mais dans le sens que lui donnent d’ordinaire les économistes, comme travail accumulé existant en argent ou en marchandises, le capital, de même que toutes les conditions de travail, y compris les forces de la nature qu’on ne rétribue pas, a une action productive dans le procès de travail, dans la création de valeurs d’usage, mais il ne devient jamais source de valeur. »[13]
Et une centaine de pages plus loin :
« L’erreur de Ricardo est de ne s’être soucié que de la magnitude de la valeur. Son attention porte par conséquent principalement sur les quantités relatives de travail que représentent les différentes marchandises ou qu’incarnent les marchandises en tant que valeurs. Mais il faut représenter comme travail social, comme travail individuel aliéné, le travail qu’elles intègrent. »[14]
Dans Les manuscrits économico-philosophiques de 1844, Marx soutient que l’aliénation du travail dans le capitalisme est en même temps une aliénation de la nature par rapport à l’homme (sic) :
« Nous avons considéré l’acte de l’aliénation de l’activité pratique humaine, c’est-à-dire du travail, sous deux aspects. 1) Le rapport du travailleur au produit du travail comme à un objet étranger et ayant barre sur lui. Ce rapport est en même temps le rapport au monde extérieur sensible, aux objets naturels comme à un monde étranger se tenant face à lui de manière hostile. […] La nature est le corps propre non organique de l’homme – où il faut entendre la nature dans la mesure où elle n’est pas elle-même le corps humain. L’homme vit de la nature signifie : la nature est son corps propre, avec lequel il faut qu’il demeure dans un processus continuel pour ne pas mourir. Le fait que la vie physique et spirituelle de l’homme soit dépendante de la nature, n’a pas d’autre sens que celui-ci : la nature est dépendante d’elle-même, car l’homme est une partie de la nature.
En ce que le travail aliéné aliène l’homme de la nature […] Le travail aliéné fait donc : de l’être générique de l’homme, aussi bien la nature que sa faculté générique spirituelle, un être qui lui est étranger, un moyen de son existence individuelle. »[15]
Cette idée a été davantage développée dans Grundrisse où Marx a, pour la première fois, présenté le processus historique qui permettrait d’expliquer la rupture de l’unité de l’humanité active et vivante avec les conditions naturelles de ses échanges métaboliques avec la nature, « Cette séparation absolue entre la propriété et le travail, entre la force de travail vivante et les conditions de sa réalisation, entre la valeur et l’activité créatrice de valeur fait que le contenu même du travail est étranger à l’ouvrier. »[16], c’est-à-dire le processus historique qui aboutit finalement à la séparation des producteurs et des moyens de production : le processus historique de ce que l’on appelle accumulation primitive.
Comme il ne manque pas de l’écrire : « Le rapport du travail au capital, ou aux conditions objectives du travail en tant que capital, présuppose un processus historique qui dissout les formes variées qui font un propriétaire du travailleur, ou sous lesquelles le propriétaire travaille. Ainsi [cela présuppose] par-dessus tout la dissolution du rapport à la terre – sol et territoire – en tant que condition naturelle de production – à laquelle il est relié comme à son propre être inorganique. »[17]
Dans ce contexte même : «En effet, la nature devient un pur objet pour l’homme, une chose utile. On ne la reconnaît plus comme une puissance. L’intelligence théorique des lois naturelles a tous les aspects de la ruse qui cherche à soumettre la nature aux besoins humains, soit comme objet de consommation, soit comme objet de production.
De même, le capital se développe irrésistiblement au-delà des barrières nationales et des préjugés ; il ruine la divinisation de la nature en même temps que les coutumes ancestrales : il détruit la satisfaction de soi, cantonnée dans des limites étroites et basée sur un mode de vie et de reproduction traditionnel. Il abat tout cela et il est lui-même en révolution constante, brisant toutes les entraves au développement des forces productives, à l’élargissement des besoins, à la diversité de la production, à l’exploitation et à l’échange de toutes les forces naturelles et spirituelles.
Le capital ressent toute limite comme une entrave, et la surmonte idéalement, mais il ne l’a pas pour autant surmontée en réalité : comme chacune de ces limites est en opposition avec la démesure inhérente au capital, sa production se meut dans des contradictions constamment surmontées, mais tout aussi constamment recréées.»[18]
C’est précisément ce qui peut être à l’origine de ces deux changements catastrophiques dans les écosystèmes localisés et périphériques et du bouleversement plus global de l’équilibre écologique planétaire. Cependant, pour savoir comment cette éventualité d’une « crise écologique » devient réalité, il faut étudier et analyser concrètement l’histoire du développement capitaliste. On ne trouvera pas immédiatement la réponse à cette question dans la dialectique abstraite des contradictions de la production de la marchandise capitaliste.
3 – La rupture dans le métabolisme.
Marx exprime en termes concrets ce que signifie matériellement la séparation de la société et de la nature dans le volume III du Capital. C’est là qu’il introduit le concept de « rupture dans le métabolisme » : la rupture du métabolisme entre la société et la nature. Cette rupture résulte du renforcement de l’opposition entre la ville et la campagne, c’est-à-dire la division géographique de la production capitaliste qui concentre les industries dans les zones urbaines et l’agriculture à la campagne. Selon cette conception, puisqu’une petite partie de la classe ouvrière est employée par l’agriculture capitaliste, la majeure partie de la population se concentre dans les villes. De cette manière, les nutriments et les éléments que l’on extrait de la terre pour produire la nourriture, les vêtements et les logements de la population ne sont pas recyclés et se transforment en polluants dans les villes. Il est évident que les phénomènes du bouleversement écologique contemporain, tels que la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore, ainsi que l’acidification des océans dont nous avons parlé dans l’introduction, peuvent être présentés en se basant sur le concept de « rupture dans le métabolisme » introduit par Marx il y a 150 ans. Dans ce contexte, voici ce qu’écrit Marx dans le volume III :
« En dehors du fait que les méthodes d’exploitation ne correspondent pas au niveau de développement social, mais aux conditions accidentelles et fort inégales dans lesquelles les producteurs sont individuellement placés, nous assistons dans ces deux formes [petite et grande culture] à une exploitation gaspilleuse des ressources du sol au lieu d’une culture consciencieuse et rationnelle de la terre, propriété commune et éternelle, condition inaliénable de l’existence et de la reproduction de générations humaines qui se relaient. […] En outre, la grande propriété foncière réduit la population agricole à un minimum toujours décroissant, lui opposant une population industrielle sans cesse croissante agglomérée dans les grandes villes.
Les conditions ainsi créées provoquent une rupture irrémédiable dans le métabolisme déterminé par les lois de la vie, d’où le gaspillage des ressources de la terre que le commerce étend bien au-delà des frontières nationales. […] La grande industrie et la grande agriculture mécanisée agissent de concert. Si, à l’origine, la première tend à ravager et à ruiner la force de travail, donc la force naturelle de l’homme, tandis que la seconde s’attaque directement à la force naturelle de la terre, elles finissent par se conjuguer dans leur marche en avant : le système industriel à la campagne affaiblit également les travailleurs et, pour leur part, l’industrie et le commerce procurent à l’agriculture les moyens d’épuiser la terre. »[19]
La rupture dans le métabolisme entre la société et la nature s’accompagne, par conséquent, du gaspillage et de la destruction de la force de travail, de la force naturelle humaine, puisque la production de la plus-value se base sur la plus grande exploitation possible de la main d’œuvre, au point de la ravager et de la déformer en augmentant le temps de travail et son intensification, mais aussi parce que la santé des travailleurs est détruite sous l’effet de la pollution. Ces deux aspects complémentaires de la destruction des forces naturelles de l’homme et de la terre sont présentés avec encore plus de clarté dans le volume I du Capital :
« Avec la prépondérance toujours croissante de la population des villes qu’elle agglomère dans de grands centres, la production capitaliste […] trouble […] les échanges organiques entre l’homme et la terre, en rendant de plus en plus difficile la restitution de ses éléments de fertilité, des ingrédients chimiques qui lui sont enlevés et usés sous forme d’aliments, de vêtements, etc. […] Dans l’agriculture moderne, de même que dans l’industrie des villes, l’accroissement de productivité et le rendement supérieur du travail s’achètent au prix de la destruction et du tarissement de la force de travail. En outre, chaque progrès de l’agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l’art d’exploiter le travailleur, mais encore dans l’art de dépouiller le sol ; chaque progrès dans l’art d’accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. […] La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du processus de production sociale qu’en épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur»[20] et :
« Le capital ne s’inquiète point de la durée de la force de travail. Ce qui l’intéresse uniquement, c’est le maximum qui peut en être dépensé dans une journée. Et il atteint son but en abrégeant la vie du travailleur, de même qu’un agriculteur avide obtient de son sol un plus fort rendement en épuisant sa fertilité. »[21]
Bien entendu, lorsque Marx fit ces observations, l’État-providence capitaliste n’existait pas encore. Contrairement à la myopie et à l’avidité des individus capitalistes, l’État-providence capitaliste tente de gérer l’exploitation de la force de travail et de la nature plus rationnellement dans le but de favoriser un déploiement plus aisé de la reproduction élargie du capital social total. Le capitalisme de l’État-providence fait à son tour apparaître de nouvelles contradictions et de nouveaux antagonismes qu’il cherche à surmonter par le biais de la politique du « développement durable » que nous présenterons et critiquerons plus loin.
Pour Marx, l’élargissement des besoins sociaux n’exige pas forcément l’aggravation de la rupture dans le métabolisme et l’épuisement des ressources naturelles à la Malthus :
« Avec son développement, cet empire de la nécessité naturelle s’élargit parce que les besoins se multiplient ; mais, en même temps, se développe le processus productif pour les satisfaire. Dans ce domaine, la liberté ne peut consister qu’en ceci : les producteurs associés – l’homme socialisé – règlent de manière rationnelle leurs échanges organiques avec la nature et les soumettent à leur contrôle commun au lieu d’être dominés par la puissance aveugle de ces échanges ; et ils les accomplissent en dépensant le moins d’énergie possible, dans les conditions les plus dignes, les plus conformes à leur nature humaine. »[22]
En d’autres termes, le communisme mettra fin à la séparation de la société et de la nature grâce à la régulation rationnelle du métabolisme avec la nature, grâce à la satisfaction des nombreux et divers besoins humains en dépensant le moins possible d’énergie et en développant de nouvelles forces productives qui n’épuiseront pas la fertilité naturelle. Jason Moore cite la « permaculture » et le « système d’intensification du riz »[23] comme des exemples de la manière dont une société communiste pourrait orienter sa production agricole.[24]
De toute manière, Marx était très clair sur ce point : ni les capitalistes ni la société humaine dans son ensemble ne sont propriétaires de la terre :
« Dans une organisation économique de la société supérieure à la nôtre, le droit de propriété de certains individus sur le globe terrestre paraîtra aussi absurde que le droit de propriété d’un être humain sur un autre. Aucune société, aucun peuple ni même toutes les sociétés d’une époque prises ensemble ne sont les propriétaires de la terre. Ils n’en sont que les possesseurs, les usufruitiers, et ils devront la léguer aux générations futures après l’avoir améliorée en bons pères de famille [boni patres familias]. »[25]
4 – L’appropriation gratuite (le pillage) des éléments de la richesse naturelle.
Dans la seconde partie de ce texte, nous montrerons pourquoi la production et l’accumulation de la valeur capitaliste est en même temps un rapport de dévalorisation de la nature non humaine. L’appropriation gratuite ou la moins coûteuse possible de tous les éléments de la richesse sociale et naturelle contribue à économiser le capital constant et variable et sert donc à accroître à la fois le taux de plus-value et le taux de profit.
« On voit ici d’une manière frappante qu’un moyen de production ne transmet jamais au produit plus de valeur qu’il n’en perd lui-même par son dépérissement dans le cours du travail. S’il n’avait aucune valeur à perdre, c’est-à-dire s’il n’était pas lui-même un produit du travail humain, il ne pourrait transférer au produit aucune valeur. Il servirait à former des objets usuels sans servir à former des valeurs. C’est le cas qui se présente avec tous les moyens de production que fournit la nature, sans que l’homme y soit pour rien, avec la terre, l’eau, le vent, le fer dans la veine métallique, le bois dans la forêt primitive, et ainsi de suite. »[26]
« On a vu que les forces productives résultant de la coopération et de la division du travail ne coûtent rien au capital. Ce sont les forces naturelles du travail social. Les forces physiques appropriées à la production, telles que l’eau, la vapeur, etc., ne coûtent rien non plus. »[27]
« Le fabricant paie son charbon ; il ne paie pas la capacité particulière à l’eau de modifier son état physique et de se faire vapeur. Cette monopolisation des forces naturelles, c’est-à-dire de l’accroissement de la force de travail qu’elles produisent, est commune à tout capital qui se sert de machines à vapeur. Il peut se faire qu’elle augmente une portion du produit du travail, celle qui représente la plus-value, par rapport à la portion qui est transformée en salaires. »[28]
En outre, l’appropriation gratuite de la richesse naturelle déprécie, chaque fois que cela est possible, le moyen de production, à savoir le capital constant, et fonctionne ainsi en tant que facteur de neutralisation dans la composition de la valeur du capital et, par conséquent, de la tendance à la baisse du taux de profit.
Nous pouvons affirmer que le capitalisme est, d’une part, contrôle du travail gratuit de la classe ouvrière dans la production de la marchandise capitaliste, dans le sens que la valeur que représentent les salaires est inférieure à la valeur produite par le travail[29], et que, d’autre part, il est contrôle à la fois du travail domestique non rémunéré (qui, à cause de la prédominance de la division sexuée du travail, est principalement effectué par les femmes) et du « travail » fourni gratuitement par les sources naturelles de la richesse. Dans le premier cas, l’exploitation du travail salarié produit de la valeur et de la plus-value. Dans le second cas, l’appropriation gratuite des valeurs d’usage produites par le « travail » non rémunéré de la nature et du travail domestique contribue à la dépréciation du capital variable et constant et, par conséquent, à l’augmentation de la plus-value et du profit. Ainsi, nous pouvons soutenir, en suivant l’analyse de Jason Moore, que le capitalisme est basé sur la fragmentation des rapports de la société capitaliste avec la nature : les forces naturelles des salariés sont internalisées dans la production capitaliste et la circulation de la force de travail sous la forme de la marchandise tandis que les forces productives de la nature non humaine et les forces naturelles des travailleurs privés de salaires sont transformées en « externalités », pour utiliser un terme de l’économie bourgeoise.
Il est possible que l’analyse ci-dessus se voie objecter que les valeurs d’usage ont souvent un prix, c’est-à-dire qu’elles peuvent être vendues et achetées ou bien louées pour une certaine somme d’argent. Marx explique ce phénomène en se basant sur le fait que, comme il est signalé dans le passage du volume III du Capital déjà cité, les forces naturelles fournissent des valeurs d’usage qui ne coûtent rien, appartiennent aux moyens de production et accroissent la productivité du travail.[30]Marx utilise l’exemple d’une chute d’eau fournissant de l’énergie à une usine :
« La détermination de la valeur par le temps de travail socialement nécessaire s’affirme par la baisse du prix des marchandises et par la contrainte de produire des marchandises dans d’aussi bonnes conditions. Il en va tout autrement du surprofit d’un capitaliste qui utilise une chute d’eau. La productivité accrue du travail qu’il emploie ne découle pas du capital, ni du travail lui-même, ni de la simple application de quelque énergie naturelle, différente du capital, mais incorporée en lui. Le fait est que le travail est naturellement plus productif quand il se conjugue avec une force de la nature – mais une force de la nature qui n’est pas aux ordres de tout capital dans la même sphère de production, comme l’est par exemple l’élasticité de la vapeur. En d’autres termes, il ne va pas de soi qu’on utilise une telle force partout où du capital est investi. Au contraire, cette force de la nature est monopolisable : la chute d’eau obéit à qui dispose de certains lots de terrain avec leurs dépendances. »[31]
« La chute d’eau, comme la terre en général, comme toute force naturelle, n’a aucune valeur parce qu’elle ne représente aucun travail matérialisé ; par conséquent, elle n’a pas de prix, car le prix, normalement, n’est autre chose que la valeur exprimée par son équivalent monétaire. Là où il n’y a pas de valeur, il n’y a rien non plus, eo ipso, qu’on doive exprimer en argent. Ce prix n’est rien d’autre que la rente capitalisée. La propriété foncière met le propriétaire en état de se réserver la différence entre le profit particulier et le profit moyen. Le profit ainsi retenu, chaque année renouvelé, peut se capitaliser, se présentant ainsi comme le prix de la force matérielle en soi. »[32]
En nous basant sur l’analyse de Marx, nous en arrivons au point où nous sommes en mesure d’expliquer ce qui se passe lorsque l’exploitation capitaliste des forces naturelles entraîne leur destruction, comme cela se produit dans l’épuisement des sols cultivés, dans la déforestation, dans la pollution de l’eau et dans l’épuisement des énergies fossiles dont l’extraction n’est pas coûteuse. Alors, selon Marx, il faut dépenser plus de capital pour aboutir au même rendement. Par conséquent, la production coûte plus cher et la rentabilité baisse.
« Dès lors, si une telle force naturelle qui, à l’origine, ne coûte rien, entre dans la production, elle ne compte pas dans la détermination du prix tant que le produit fourni avec son aide suffit aux besoins. Mais, si au cours du développement, il faut fournir plus de produits que l’on en pourrait obtenir grâce à cette force naturelle, autrement dit si ce produit additionnel doit être créé sans l’aide de cette force ou avec le concours du travail humain, un nouvel élément additionnel entre dans le capital. Une dépense relativement plus grande de capital est donc nécessaire pour obtenir le même produit. Toutes autres circonstances restant égales, il y aura renchérissement de la production. »[33]
De toute évidence, les conséquences sont les mêmes lorsque la productivité des forces naturelles diminue parce qu’elles sont gaspillées par la production capitaliste. Dans ces moments-là, les capitalistes se souviennent qu’il convient de mettre en œuvre une « gestion rationnelle des ressources naturelles », prétendant que les ressources ont été gaspillées parce qu’elles échappent au droit de propriété, conséquence de la célèbre « tragédie des biens communs », concept selon lequel « les ressources communes s’épuisent parce que leurs utilisateurs ne paient pas pour les dégâts qu’ils leur infligent ». Assurément, ces théories d’ « économie environnementale » sont de faux repentirs qui n’ont d’autre but que de transférer le renchérissement du capital aux prolétaires par le biais de taxes sur la consommation et le versement de subventions aux entreprises capitalistes qui adoptent des « technologies compatibles avec l’écologie ».
En partant de là, nous procèderons à une critique plus détaillée des « solutions » que propose l’ « économie environnementale » face à la prétendue « crise écologique ».
5 – Sur les « limites de la croissance », l’ « économie durable », le concept de « développement durable » et autres idéologies capitalistes.
Dès le milieu des années 1980, la « science de l’économie » (ou, plus précisément, l’idéologie apologétique bourgeoise) émet fréquemment l’hypothèse que le « capital créé par l’homme » peut se substituer totalement au « capital naturel ».[34] Cependant, face à cette hypothèse, les premières prises de position critiques étaient déjà apparues au cours des années 1970 dans les cercles académiques capitalistes. Leur point de départ fut la publication en 1971de l’étude de Forrester sur les « dynamiques urbaines et mondiales ». Cette étude utilisait des modèles mathématiques afin de prouver que la croissance économique mène à l’épuisement des ressources naturelles et, par conséquent, pour prouver que l’industrialisation des pays « en voie de développement » est infaisable ou indésirable parce qu’elle conduit de facto à la propagation de maladies, à l’émergence de conflits sociaux et ainsi de suite.[35] Basé sur cette étude, le rapport intitulé Halte à la croissance ?, qui arrivait aux mêmes conclusions, fut publié en 1972 par le Club de Rome,[36] financé par Volkswagen et vendu à plus de 30 millions d’exemplaires. Finalement, l’économiste Herman Daly proposa en 1977 la création d’une « économie durable ». Selon lui, l’économie capitaliste doit atteindre un état d’équilibre dans lequel l’échange de matière et d’énergie avec la nature se poursuivra à un rythme lent, par analogie avec les organismes vivants. Cet apologiste particulier du capitalisme soutenait ceux qui pensaient qu’il est impossible que la planète toute entière puisse partager le niveau de vie des pays développés et qu’il faudrait imposer des limites à la population mondiale afin « de ne pas outrepasser les limites naturelles pour la survie de l’humanité ».
Ce n’est pas une coïncidence si ces idéologies sont apparues au même moment que la profonde crise de reproduction des rapports sociaux capitalistes qui éclata dans les années 1970 à la suite des luttes sociales et des luttes de classe dans toutes les sphères de la production et de la vie quotidienne. Cette fois-là, on affronta la crise par le biais du monétarisme, politique de dévaluation générale du capital constant et variable. Le passage de Forrester que nous allons citer est représentatif de l’état d’esprit capitaliste à cette époque : « À mesure que les pauvres commencent à prédominer, leur pouvoir politique se fait sentir. Leur intérêt à court terme l’emporte sur leur propre bien-être à long terme et sur celui de la cité. […] si ce pouvoir politique est trop grand, les impôts peuvent continuer à augmenter et le déclin peut continuer à s’accélérer jusqu’à ce que l’économie de la zone urbaine commence à s’effondrer et que toutes les classes de la population déclinent. »[37] En outre, le rapport du Club de Rome affirmait que « promettre que la poursuite de notre modèle actuel de croissance rendra tous les hommes égaux » relève du mythe. Par conséquent, il est clair que le but de ces idéologies du capital consistait à promouvoir une stratégie qui renierait la promesse social-démocrate de prospérité sociale grâce à la « croissance économique », puisque cette promesse traversait une profonde crise à ce moment-là.[38]
Si l’idéologie de la « stabilité », c’est-à-dire de la stagnation économique, correspondait aux politiques monétaristes luttant contre l’inflation et imposées pendant la seconde moitié des années 1970, elle n’avait cependant pas la même utilité pendant les phases hautes du cycle d’accumulation capitaliste. À la fin des années 1980, on élabora une nouvelle stratégie d’accumulation capitaliste qui tentait de surmonter les « contradictions écologiques » du capitalisme. Nous entendons par là la stratégie du « développement durable », exposée pour la première fois en 1987 dans le rapport intitulé « Notre avenir à tous » et qui était rédigé par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations Unies.[39] D’après ce rapport, « le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ».[40] Dans un discours prononcé l’année suivante par le président de la commission et premier ministre de la Norvège, à cette époque Gro Harlem Brundtland, on affirmait la nécessité d’élaborer « une nouvelle éthique holistique selon laquelle la croissance économique et la protection de l’environnement iront de concert dans le monde entier ».
Comme nous l’avons dit plus haut, le discours sur le « développement durable » attribuait le gaspillage des ressources naturelles et la diminution de leur productivité au fait qu’elles échappaient au droit de propriété. La « solution » proposée était basée sur le théorème de « l’économie de l’environnement » qu’avait introduit l’économiste R. H. Coase, lauréat du Prix Nobel, et selon lequel « lorsqu’une ressource collective est polluée, si le droit de propriété sur cette ressource est attribué à l’une des parties concernées, c’est-à-dire au pollueur ou à celui qui subit la pollution, un mécanisme de transaction se mettra automatiquement en place, et il aboutira à un niveau de pollution optimal et à la maximisation du profit social net […] ce qui aboutira à une répartition optimale des ressources disponibles ».[41]
Le caractère apologétique de la théorie de l’environnement néoclassique.
Afin de mieux saisir le contexte dans lequel le théorème cité ci-dessus a été formulé, une brève digression s’impose afin de commenter la doctrine économique capitaliste dominante, la théorie économique néoclassique. La théorie économique néoclassique a pour objet d’étudier la répartition et l’usage optimaux des « ressources rares » disponibles pour la satisfaction des besoins et des désirs des sujets économiques. Les idées de base de la théorie néoclassique sont les suivantes : a) la société est composée de sujets économiques indépendants (individus et entreprises), qui b) prennent des décisions rationnelles selon leurs préférences et qui visent à la maximisation de leur utilité individuelle (utilitarisme) ; les prix des marchandises sont des indicateurs de leur rareté par rapport aux préférences de tous les sujets économiques.
Cette description suffit à mettre en évidence le caractère idéologique et faux de la théorie néoclassique : les rapports capitalistes de pouvoir et de dépendance disparaissent puisqu’on tient pour acquis que les sujets économiques (individus et entreprises) prennent leurs décisions indépendamment les uns des autres, la société se transforme en une somme d’individus et d’entreprises sans que soit reconnue l’existence de sujets sociaux et de classes, les rapports sociaux historiques et les rapports personnels se transforment en un ordre des choses anhistoriques, éternel et naturel, et ainsi de suite. Outre la critique générale de la théorie néoclassique que l’on peut faire, la question du gaspillage des ressources et des forces naturelles révèle ses contradictions logiques inhérentes. Selon la théorie néoclassique, puisque ces « marchandises » ont été gaspillées et sont devenues « rares », les « sujets économiques » auraient dû leur attribuer un prix. Mais ce n’est pas ce qui se produit. Pour justifier l’échec total de la théorie néoclassique, les économistes bourgeois ont inventé le concept ad hoc d’ « échec du marché », ce qui en réalité ruine les propres fondements méthodologiques de leur théorie.
Le théorème de Coase est essentiellement une tentative de sauver la théorie néoclassique puisqu’il rejette sur des « erreurs du marché » le défaut d’attribution de droits de propriété explicites (transférabilité, exclusivité, etc.) sur les ressources naturelles. Si l’on étudie, par exemple, le cas d’une entreprise polluante et d’une communauté locale qui subit cette pollution, selon le théorème de Coase, le droit de propriété sur la ressource polluée devrait être attribué à l’une des deux parties afin que s’engage un processus de négociations qui finira par aboutir à la répartition optimale des ressources (si les coûts de la transaction sont nuls). C’est sur cette base idéologique qu’ont été fondées les interventions des États nationaux et des organisations supra nationales pour « fixer le prix » des « externalités de l’environnement » et attribuer des droits sur la pollution, sur les émissions de gaz à effet de serre par exemple.
Pour montrer à quel point le théorème de Coase est risible, nous utiliserons l’exemple – très répandu dans les livres d’économie – de l’usine chimique qui pollue un lac dans lequel pêchent les pêcheurs d’un village bâti sur son rivage. Disons, par exemple, que l’usine chimique dégage un bénéfice de 130 euros par jour si elle n’installe pas de filtres pour ses déchets. Dans le cas contraire, le bénéfice tombe à 100 euros par jour. Disons que les pêcheurs réalisent un bénéfice de 100 euros par jour si le lac est propre et de 50 euros par jour dans le cas contraire. Si le droit de propriété (sur la pollution du lac) est accordé à l’usine, selon le théorème de Coase les pêcheurs verseraient 40 euros par jour à l’usine afin qu’elle filtre ses déchets. Ainsi, ils feraient un bénéfice de 60 euros par jour et l’usine un bénéfice de 140 euros par jour. Les deux parties gagneraient donc 10 euros par jour et le « bien-être social net » serait de 200 euros. Si le droit de propriété était accordé aux pêcheurs, l’usine devrait compenser les 50 euros quotidiens qu’ils perdent. Alors, selon le théorème, l’usine préfèrerait filtrer ses déchets et perdre 30 euros par jour plutôt que 50. Par conséquent, l’usine et les pêcheurs feraient tous deux 100 euros de bénéfice par jour et le « bien-être social net » serait aussi de 200 euros.
Le caractère arbitraire le plus grave de l’analyse néoclassique de la pollution du lac apparaît dans l’évaluation économique de la pollution en termes de perte de revenu pour les pêcheurs et, ce qui est très important, dans le fait d’assimiler bien-être social et profit capitaliste. Cette assimilation masque et justifie l’exploitation capitaliste et exprime non seulement l’indifférence envers les besoins sociaux mais également la dévalorisation capitaliste du travail, comme nous l’avons déjà démontré. La reconstitution naturelle d’un bien tel qu’un lac peut prendre des décennies ou des siècles (voire même être impossible si, par exemple, tous les organismes vivants dans le lac meurent). Par conséquent, l’évaluation d’une telle catastrophe en termes monétaires est une preuve de la séparation extrême de la société et de la nature et ne peut en aucun cas être mesurée en termes de perte de revenu à court terme pour les pêcheurs. C’est d’autant plus vrai si l’on étudie une ressource naturelle à une échelle géographique plus vaste : les océans, l’air, ou la biodiversité.[42] En ce qui concerne le « bien-être social » néoclassique, l’équilibre économique optimal, qui est évalué en termes monétaires, peut très bien correspondre à un scénario de pollution extrême si les chiffres choisis dans l’exemple précédent avaient été différents (et tout aussi arbitraires).
En outre, ce modèle néoclassique exclut tout rapport de l’humanité à la nature qui ne soit pas lié à l’accumulation capitaliste et à la production de profit, puisqu’il est totalement neutre en ce qui concerne les conséquences que pourrait avoir la destruction d’une ressource naturelle sur ceux qui en jouissent et l’utilisent hors de son contexte économique. Enfin, même si dans l’intérêt du débat, nous acceptions l’évaluation économique de la pollution, l’analyse néoclassique traite les deux parties comme si elles étaient de conditions égales et avaient le même pouvoir économique. Rien n’est plus loin de la vérité : il serait impossible, par exemple, à des gens qui luttent contre l’extraction de l’or à Skouries (en Chalcidique, Grèce) de réunir assez d’argent pour soudoyer Eldorado afin que l’entreprise renonce à étendre ses activités minières (et il risible de même penser à un scénario de ce genre).
La stratégie du « développement durable ».
« La soi-disant « lutte contre la pollution », par son côté étatique et règlementaire, va d’abord créer de nouvelles spécialisations, des services ministériels, des jobs, de l’avancement bureaucratique. Et son efficacité sera tout à fait à la mesure de tels moyens. Elle ne peut devenir une volonté réelle qu’en transformant le système productif actuel dans ses racines mêmes. »
Guy Debord, La planète malade.
C’est dans ce contexte que s’est articulée la stratégie du « développement durable », qui tente d’ « internaliser les économie externes de l’environnement ». Les principaux instruments qu’utilisent dans ce but l’État capitaliste et les organisations capitalistes supra nationales sont les suivants :
- Versement de subventions aux entreprises polluantes pour qu’elles adoptent des technologies limitant la pollution. Ces subventions proviennent soit des impôts directs prélevés sur les salariés, soit d’impôts indirects sous forme de taxes sur la consommation. En Grèce, les tarifs élevés de l’énergie renouvelable apparaissant sur les factures d’électricité sont un exemple représentatif de ce genre d’impôt. Comme nous l’avons déjà dit, de cette manière l’État impute le coût accru du capital constant, dû au déclin de la productivité des forces naturelles ou à l’épuisement des ressources naturelles, à la classe ouvrière, qui paie la majeure partie des impôts directs et indirects. De cette façon, le taux de plus-value augmente et on enraye le déclin du taux de profit.
- Vente de permis de polluer et création de systèmes d’échange de quotas d’émissions de carbone.[43] La création des marchés du carbone a été instituée en 1997 par le Protocole de Kyoto. Ce protocole fixe le plafond des émissions de carbone, pour chaque pays. Si un pays dépasse cette limite, il devra, pour pouvoir poursuivre ses émissions, acheter une licence à un autre pays n’ayant pas dépassé son quota. Chaque pays attribue des quotas d’émissions aux plus grandes entreprises qui en sont responsables. Si une entreprise dépasse ses quotas, elle devra, pour éviter de payer une lourde amende, acheter une licence d’émissions à une autre entreprise. De cette manière, soi-disant, si une entreprise investit dans de la « technologie verte » qui lui permet de réduire ses émissions de dioxyde de carbone, alors elle pourra vendre la licence correspondante sur le marché et ainsi générer un revenu qui couvrira ses coûts d’investissement. En outre, le Protocole de Kyoto comprend le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP), selon lequel les pays développés et les entreprises qui y travaillent peuvent acheter des « crédits d’émissions » grâce à la mise en œuvre de projets de « développement propre » dans les pays du Sud qui produisent peu d’émissions et ne sont pas obligés de les réduire. Hormis le marché des MDP qui est supervisé par les Nations Unies, il y a aussi le Marché Compensatoire Volontaire (MCV) qui ne fait pas partie du système officiel de réduction des émissions et n’est pas basé sur les licences et les amendes prévues par le Protocole de Kyoto.
En pratique, les quotas d’émissions de dioxyde de carbone accordées à l’origine aux pays développés étaient très élevés, et par la suite, nombre de grandes entreprises du Nord, au lieu de réduire leurs émissions de dioxyde de carbone pour atteindre les buts fixés à Kyoto, ont fait (et continuent à faire) des investissements dans de soi-disant projets de « développement propre » dans les pays du Sud afin d’acheter des « crédits d’émissions ». Certaines entreprises, telles que Land Rover, prétendent frauduleusement qu’elles n’émettent pas de dioxyde de carbone parce qu’elles ont investi dans des éoliennes ou des biocarburants dans des pays moins développés, compensant ainsi et « exportant » leurs propres émissions. Cela s’applique également à des pays tout entiers qui paraissent se conformer aux objectifs de Kyoto parce qu’ils achètent des « crédits d’émissions ». Ainsi, plutôt que travailler à une réduction des émissions de dioxyde de carbone, les marchés d’émissions encouragent l’investissement capitaliste des pays développés dans les pays du Sud et mettent sur pied une opération lucrative supplémentaire. Lorsque les soi-disant projets de « développement propre » dans le Sud n’augmentent pas les émissions mondiales de dioxyde de carbone sur la planète en raison de l’expansion des activités industrielles, ils créent des problèmes environnementaux supplémentaires, tels que la diminution de la fertilité des sols à cause des investissements en biocarburants qui entraînent une augmentation des prix alimentaires[44], l’utilisation accrue d’engrais chimiques parce que les cultivateurs des pays « en voie de développement » sont privés des engrais naturels désormais utilisés comme biocarburants, la perte de la biodiversité due à la destruction d’habitats entiers de faune sauvage et l’extermination d’importantes populations d’oiseaux due à l’installation des parcs d’éoliennes, et ainsi de suite.
- Développement du marché de la consommation verte et de l’écotourisme. Cette tactique vise à récupérer les inquiétudes concernant le gaspillage et la destruction des ressources naturelles et à les incorporer dans la soi-disant consommation verte dont on sait qu’elle constitue une niche de marché prometteuse. L’écotourisme, tout particulièrement, a entraîné une surexploitation des régions touristiques du monde sous-développé. Les programmes de protection de l’environnement dans les pays du Sud conduisent souvent à l’expulsion violente de populations locales qui perdent leur accès à la terre et aux ressources naturelles, phénomène qui est partie prenante des processus d’accumulation primitive en cours dans la périphérie capitaliste.[45]
- Promotion de la doctrine du « consommateur responsable» et du « comportement écologique ». Cette doctrine vise à transférer aux comportements individuels la responsabilité des rapports sociaux capitalistes et elle fait obstacle au développement des mobilisations collectives contre le gaspillage des ressources naturelles.
Par conséquent, comme nous avons tenté de le démontrer, et pour dire les choses comme elles sont, la politique de l’environnement capitaliste est dirigée contre la nature et contre la satisfaction des besoins sociaux en reproduisant la séparation et l’aliénation de la société et de la nature. Outre le transfert aux prolétaires du coût des dégâts causés à l’environnement, elle vise également à la création de nouvelles possibilités lucratives d’investissements de capitaux.
6 – Luttes contre le pillage capitaliste de la nature.
Depuis les années 1970, des luttes sociales ont éclaté partout dans le monde contre l’exploitation capitaliste, le pillage et la dévalorisation de la nature, dont les conséquences affectent principalement, d’une part les fractions les plus opprimées de la classe ouvrière[46] et, d’autre part, des populations indigènes qui n’ont plus accès à leurs moyens de subsistance dans le contexte d’un processus en cours d’accumulation primitive, c’est-à-dire la destruction des communautés indigènes précapitalistes, l’extension des rapports capitalistes à tous les recoins du monde, et la prolétarisation des peuples indigènes. Ces luttes éclatent tout au long de la chaîne de production de la marchandise capitaliste, depuis l’extraction des ressources naturelles et leur transformation industrielle jusqu’au transport et au ramassage des rebuts et des déchets, dès lors que les communautés en lutte défendent leur environnement naturel et leurs vies. Bien qu’elles aient au départ un caractère local, elles se transforment souvent, par leur degré d’organisation et d’influence, en événements nationaux.
Quelques statistiques sur les luttes.
L’ « Atlas de la justice environnementale » (EJatlas) contient le tableau I, qui présente les principaux axes autour desquels ont éclaté les luttes sociales pour l’environnement au cours des 40 dernières années. La première colonne dresse la liste des catégories les plus générales, qui sont analysées plus en détail dans la seconde colonne. Quant à leur fréquence, la plupart de ces luttes ont éclaté autour de l’extraction des minerais (21 %), de l’extraction des carburants (19 %), des revendications sur l’accès à la terre (17 %), et la gestion de l’eau (14 %), notamment autour de la construction de barrages hydroélectriques. Donc la plupart des luttes ont lieu au stade de l’extraction des ressources naturelles nécessaires à la production capitaliste. Quant à leur localisation géographique, la plupart d’entre elles se déroulent dans des zones rurales (63 %) tandis que seulement 17 % ont lieu dans des zones urbaines, et le reste dans des zones semi-urbaines. Dans les zones rurales, ces luttes concernent surtout la clôture ou l’annexion des richesses naturelles par l’État ou par des entreprises capitalistes et le fait que les populations locales se retrouvent dépossédées des ressources indispensables à leur survie. Elles concernent également l’élimination des déchets et rebuts de la production capitaliste (le démantèlement des navires, par exemple) ainsi que des projets liés au « Mécanisme de Développement Propre » qui sont censés faire partie de la réduction des émissions de dioxyde de carbone.
Les luttes dans les zones urbaines et semi-urbaines tournent principalement autour de projets d’infrastructures et de développement tels que l’extension des ports et aéroports, des processus de gentrification et de redéveloppement de quartier historiques (voir, par exemple, les mobilisations autour de la destruction du parc Gezi à Istanbul qui a déclenché une révolte générale), l’extension de zones industrielles, la gestion et le ramassage des ordures ménagères et industrielles.
| Catégories du 1er niveau (mutuellement exclusives) | Classification du 2nd niveau (choix multiple parmi les catégories), quelques exemples |
| Énergie nucléaire | Extraction de l’uranium – centrales nucléaires – stockage des déchets nucléaires |
| Extraction de minerais et matériaux de construction | Extraction des minerais- transformation des minerais- déchets miniers – extraction des matériaux de construction |
| Gestion des déchets | Zones d’importation des déchets électroniques et autres – démolition de navires – privatisation des déchets – récupérateurs de déchets – incinérateurs – décharges sauvages – déchets industriels et municipaux |
| Biomasse et conflits autour de la terre | Achats de terres – plantations d’arbres – exploitation forestière – produits autres que le bois – déforestation – pesticides – organismes génétiquement modifiés (OGM) – biocarburants – mangroves contre crevettes – bio piratage et bio prospection – production alimentaire intensive (monoculture et bétail) – pêcheries |
| Combustibles fossiles et justice climatique/énergie | Extraction de gaz et de pétrole – marées noires – torchage de gaz – extraction du charbon – conflits liés au changement climatique (glaciers et petites îles) – REDD (réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts) – MDP (mécanisme de développement propre) – éoliennes – fracking (gaz) |
| Infrastructures et construit | Mégaprojets – trains à grande vitesse – aéroports – développement urbain |
| Gestion de l’eau | Barrages – transferts de l’eau – aquifères – voies navigables – désalinisation |
| Conflits autour de la préservation de la biodiversité | Espèces invasives – dommages à la nature – conflits autour de la préservation de l’environnement |
| Conflits autour de l’industrie et des services | Emissions des usines – pollution industrielle |
| Conflits autour des loisirs et du tourisme | Installations touristiques |
Tableau I – Classification des conflits dans l’Atlas de la justice environnementale.
En ce qui concerne la composition sociale des luttes contre le pillage capitaliste de la nature, dans de larges proportions (plus d’un tiers des cas), elles sont menées par des communautés indigènes dans les pays du Sud. Ces populations indigènes subissent l’expansion du mode de production capitaliste dans des régions qui n’ont pas encore été touchées par l’appropriation de la richesse naturelle inexplorée et par la promotion de nouveaux processus d’accumulation primitive[47]. Plus souvent encore, les luttes sont le fait de groupes de résidents et de fermiers organisés localement. Dans certains cas, on note la participation de travailleurs de l’industrie et plus rarement, de travailleurs informels et de récupérateurs de déchets.
Les mobilisations prennent des formes variées qui vont de lettres de réclamation, de pétitions et de procès à des manifestations de rue, des blocages et des occupations de lieux et de bâtiments publics. Il est rare que soient adoptées des formes de mobilisation plus énergiques, telles que le sabotage, les incendies volontaires, les attaques de la propriété capitaliste, ou même des formes extrêmes comme les grèves de la faim et l’auto-immolation. De toute façon, c’est la voie institutionnelle que l’on choisit plus souvent que l’action directe. Cependant, on utilise très fréquemment le blocage des routes car il est efficace, particulièrement lorsque l’accès à la mine, à la forêt ou à la montagne à exploiter est difficile et qu’il existe peu de voie d’accès.
D’après les statistiques de l’AJatlas, l’issue des conflits n’est généralement pas favorable. Ce sont les projets touristiques et de gestion de déchets auxquels on met le plus souvent fin (plus de 30 % des cas). Ce sont les projets pour les carburants fossiles (par exemple les forages pétroliers) et les projets pour la gestion de l’eau (par exemple les barrages hydroélectriques) qui sont le plus rarement arrêtés (dans moins de 15 % des cas). Les participants aux mobilisations reconnaissent eux-mêmes 49 % d’échecs et seulement 17 % de réussites. Dans nombre de cas, les compensations succèdent aux mobilisations.
En ce qui concerne les arguments utilisés au cours de ces luttes, si l’on critique les grandes entreprises capitalistes, si l’on cite et si l’on fustige l’annexion des « biens communs » et le fardeau inégal imposé aux populations les plus pauvres du Sud, on assiste rarement à une critique exhaustive des rapports de classe de l’exploitation et de la domination capitalistes ou de la forme étatique. Dans nombre de cas, ces luttes exigent la reconnaissance des droits constitutionnels des peuples indigènes, l’extension des droits humains afin d’y inclure, par exemple, le « droit à l’eau », et les « droits à la nature », la responsabilité des entreprises, la reconnaissance de la soi-disant « dette écologique » du « Nord » envers le « Sud » (contrairement à la dette financière de ce dernier envers le premier), ainsi que la taxation des entreprises polluantes et la limitation de leurs opérations. Bien que ces exigences s’adressent de facto aux États capitalistes et aux organismes supra nationaux du capitalisme mondialisé, ces luttes pourraient contribuer à la rupture révolutionnaire du circuit de reproduction du capital social total si elles se transformaient radicalement et devenaient partie prenante d’un vaste mouvement contre l’exploitation capitaliste de la nature humaine et non-humaine en se reliant à d’autres luttes dans des sphères différentes de la production et de la reproduction capitalistes.
Ce sont des idéologies réformistes récentes qui font obstacle à l’évolution des luttes dans un sens révolutionnaire. Nous ne pouvons ici en critiquer qu’une : la doctrine de la « décroissance », qui est devenue particulièrement populaire ces dernières années au sein des groupes et des organisations qui participent aux luttes contre le pillage de la nature.
Sur la doctrine de la « décroissance ».
Cette doctrine n’est rien d’autre qu’une nouvelle version (faussement) plus radicale de celles de la « fin de la croissance » et de l’ « économie durable » présentées dans la première partie de cet article. En outre, ce n’est pas une coïncidence si elle apparaît aussi à un moment où des politiques déflationnistes de dévalorisation du capital sont à nouveau mises en avant. Selon la définition qu’en donnent Schneider, Kallis, et Martinez-Allier, la « décroissance » est une « réduction équitable de la production et de la consommation qui accroît le bien-être humain et améliore les conditions écologiques au niveau mondial et local, à court et à long terme ».[48] Pour tenter de dissocier la « décroissance » de la politique capitaliste actuelle, ils sont prompts à faire remarquer qu’il convient de la distinguer de la « récession soutenable ». Pour en juger, nous allons d’abord étudier les écrits de Serge Latouche qui est le théoricien le plus important du courant de la « décroissance ».
Selon Latouche[49], la « décroissance » implique de décoloniser la vie en sortant du consumérisme et de l’économie, de libérer l’ « imaginaire social » de sa foi prépondérante en la domination de la nature et en une « société autonome » (si cela veut dire quelque chose). La définition que donne Latouche de la croissance est la même que celle de Marx, à savoir l’expansion illimitée du capital. Cependant, pour Latouche, l’argent, le marché et le travail salarié ne sont pas des formes du rapport entre le capital et le travail mais doivent être compris comme des institutions distinctes et autonomes qui peuvent être incorporées dans une « société du post-développement » ! Il est révélateur que Latouche considère qu’il est impossible de mettre en œuvre ne serait-ce qu’une politique de taxation des entreprises polluantes ou destructrices des ressources naturelles, afin de les obliger à payer intégralement les coûts des dégâts et des risques qu’elles infligent à la société, puisqu’une telle solution nous « confronterait au véritable pouvoir de l’oligarchie ploutocratique qui gouverne le monde » et échouerait immédiatement si elle n’était précédée d’un « changement de notre imaginaire ».
Latouche s’oppose donc explicitement à une révolution communiste qui abolirait l’argent et le travail salarié. Comme il l’écrit dans un article publié dans le Monde Diplomatique : « Il ne peut exister de société basée sur la contraction de l’économie dans le capitalisme. Mais capitalisme est un terme faussement simple pour parler d’une histoire longue et complexe. Si l’on se débarrassait des capitalistes, si l’on interdisait le travail salarié, l’argent et la propriété privée des moyens de production, on plongerait la société dans le chaos. Cela provoquerait le terrorisme à grande échelle. Et cela ne suffirait pas encore à éradiquer la mentalité de marché. Nous devons trouver un autre moyen pour sortir du développement, de l’économisme (croyance en la primauté des causes ou facteurs économiques), et de la croissance : un moyen qui n’implique pas l’abandon des institutions sociales que l’économie a annexées (monnaie, marchés et même salaires) mais les ré- enchâsse selon des principes différents ».[50] Au lieu d’un changement révolutionnaire, il propose l’adoption d’un programme réformiste pour l’ « internalisation des déséconomies externes » infligées à la société par les entreprises polluantes, ce qui « ouvrirait la voie à une société de la décroissance », alignée sur la théorie orthodoxe de l’économie. Dans le même article, il proposait les mesures suivantes :
- Réduire notre empreinte écologique de manière à ce qu’elle soit égale ou inférieure à la somme des ressources de la Terre. Cela signifie ramener la production matérielle à ses niveaux de années 1960 et 1970.
- Internaliser les coûts de transport.
- Relocaliser toutes les activités.
- Revenir à l’agriculture à petite échelle.
- Réduire des trois-quarts les gaspillages d’énergie.
- Imposer lourdement les dépenses publicitaires.
- Décréter un moratoire sur l’innovation technologique.
De cette manière, selon Latouche, on peut réorienter la société vers la « voie vertueuse de l’éco capitalisme » !
Hormis cette prise de position clairement contre-révolutionnaire, la bible de la décroissance latouchienne, connue sous le nom de Petit traité de décroissance sereine, recèle de nombreux points discutables. Par exemple, l’auteur soutient ouvertement des politiques nationalistes protectionnistes et plaide en faveur de « la redécouverte des racines locales » (le code signalant ce but est le verbe « relocaliser »). En outre, Latouche est favorable aux agences d’emploi temporaire au motif qu’elles contribuent à « raccourcir la semaine de travail » et qu’elles offrent des « emplois variés », ce qui revient à dire qu’il recommande chaudement le travail précaire ! Il dit précisément qu’elles « représentent un pas dans la bonne direction. Il suffit de les envisager autrement ».
De plus, il est clair que Latouche utilise le concept de l’ « imaginaire » de Castoriadis de manière à favoriser le transfert de la responsabilité de la dévalorisation et du pillage de la nature à l’individu que l’on presse de changer ses habitudes de consommation et son style de vie.
Mais Latouche n’est pas seul à avoir des idées réformistes. Une autre théoricienne de la « décroissance », Joan Martinez-Allier, a proposé la mise en œuvre d’un « New Deal Vert » après la Grande Récession de 2008-2009 qui limiterait la montée du chômage grâce à l’investissement public dans des « technologies et des infrastructures vertes ». Cette théoricienne a prétendu que si le « keynésianisme vert » ne se transformait pas en doctrine de « croissance économique continue », il ne serait pas incompatible avec le projet de la « décroissance ».
Enfin et surtout, Calos Taïbo, adepte anarchiste de la « décroissance » soutient chaleureusement les idées de Latouche sur l’exemplarité « décroissante » que sont censées représenter les communautés indigènes dans l’Afrique moderne. « L’Afrique, qui réussit s’organiser au sein des privations et à faire exister une réelle joie de vivre, est probablement le meilleur contexte pour évaluer le malheur que représentent la croissance et le développement ».[51] Il est vraiment scandaleux qu’un anarchiste érige la pauvreté et le malheur de l’Afrique en modèle de vie sociale, sans parler de l’idéalisation des relations patriarcales précapitalistes dans les communautés indigènes. Taïbo partage les idées néo-malthusiennes du courant de la « décroissance » en ce qui concerne le prétendu problème de la surpopulation. Lorsqu’il parle de ce « problème », Taïbo pense, comme Albert Jacquard, que la « réponse à la question de savoir « combien d’habitants la Terre peut-elle nourrir ? » dépend de quel genre d’habitants on parle. Si l’on parle de fermiers au Mali ou au Bengladesh, quinze, vingt, ou même trente milliards survivraient sans trop de peine. Si l’on parle du Parisien moyen, qui circule quotidiennement en voiture et passe ses vacances aux Seychelles, les cinq milliards actuels représentent déjà une charge insupportable : ils épuiseraient les ressources de la planète ».[52]En d’autres termes, Taïbo est favorable à la chute du niveau de vie des prolétaires dans les pays développés au niveau de celui des pays pauvres du Sud. En outre, une telle prise de position favorise la propagande culpabilisante et l’individualisation du problème social de la dévalorisation de la nature.
La question de la « surpopulation ».
Nous allons étudier la théorie de la surpopulation plus en détail afin d’en montrer le caractère apologétique.
C’est Robert Malthus qui, en 1798, a présenté pour la première fois le concept de surpopulation dans son ouvrage Essai sur le principe de population[53]. Selon Malthus, la pauvreté, la faim, la maladie et la guerre ne découlent pas des rapports sociaux dominants mais sont la conséquence inéluctable de la prétendue « loi naturelle » qui stipule que la population tend à s’accroître de façon géométrique tandis que les ressources et moyens de subsistance s’accroissent de manière arithmétique, loi qui fonctionne de manière « totalement indépendante de toute régulation humaine ». La théorie de Malthus fut d’emblée dirigée contre les déclarations sur l’égalité exprimées pendant la Révolution française et elle avait clairement un caractère de classe. Malthus s’opposait, en particulier, à ce que l’État subventionne les pauvres, affirmant que cela entraînerait une croissance de leur nombre et un déclin de l’envie de travailler qui aboutiraient à une réduction progressive de leur niveau de vie et, plus important encore, à une diminution des « parts [de richesse] qui appartiendraient autrement à des membres de la société plus industrieux et plus méritants » [c’est-à-dire les bourgeois et les propriétaires terriens]. Sa théorie était extrêmement contradictoire car dans son ouvrage, Principes d’économie politique, il reconnaissait que la demande sociale pour les produits de la production capitaliste faisait défaut et qu’il s’agissait d’un phénomène habituel. La « solution » qu’il proposait passait par une augmentation de la consommation des couches sociales supérieures non productives (propriétaires terriens, fonctionnaires de l’État, aristocrates, clergé, rentiers, etc.). Conscient de cette contradiction, il tenta de la surmonter en affirmant que les couches supérieures n’augmentent pas leur nombre selon la loi naturelle mais le régulent en adoptant des habitudes de prudence dues à la crainte de perdre leur position sociale, contrairement aux « classes inférieures » qui se reproduisent imprudemment. En outre, il fut assez honnête pour reconnaître que la demande ne pourrait pas être couverte par la classe ouvrière, car « personne n’utilisera jamais son capital simplement pour générer la demande de ceux qui travaillent pour lui », avouant indirectement que les profits proviennent forcément de l’exploitation de la classe ouvrière.
Pour Malthus, les salaires insuffisants des travailleurs découlent soit d’une distribution inégale de la richesse sociale soit de l’épuisement graduel du sol si les salaires et la consommation de la classe ouvrière sont plus élevés que la terre ne peut le supporter. Par conséquent, la création par les classes dirigeantes d’une rareté artificielle à l’intention des travailleurs fait obstacle à l’immisération de tous les secteurs de la société et « assure à une fraction de la société le loisir nécessaire au progrès des arts et des sciences ».
Marx a attaqué la doctrine malthusienne de la surpopulation et de la rareté de la ressource naturelle : il a montré pourquoi la pauvreté de la classe ouvrière n’est pas la conséquence d’une prétendue « loi naturelle de la population » et de la rareté des ressources naturelles mais de la dynamique interne du mode de production capitaliste. Pour Marx, l’accumulation du capital exige l’accroissement de la population afin de disposer d’une armée de réserve industrielle nécessaire à son expansion. De plus, comme il le souligne, la loi de la population « correspond à son mode de production particulier. En effet, chacun des modes historiques de la production sociale a aussi sa loi de population propre, loi qui ne s’applique qu’à lui, qui passe avec lui et n’a par conséquent qu’une valeur historique. Une loi de population abstraite et immuable n’existe que pour la plante et l’animal, et encore seulement tant qu’ils ne subissent pas l’influence de l’homme. […]
Si l’accumulation, le progrès de la richesse sur la base capitaliste, produit donc nécessairement une surpopulation ouvrière, celle-ci devient à son tour le levier le plus puissant de l’accumulation, une condition d’existence de la production capitaliste dans son état de développement intégral. Elle forme une armée de réserve industrielle qui appartient au capital d’une manière aussi absolue que s’il l’avait élevée et disciplinée à ses propres frais. Elle fournit à ses besoins de valorisation flottants, et, indépendamment de l’accroissement naturel de la population, la matière humaine toujours exploitable et toujours disponible. »[54] Cela ne signifie pas que Marx ne voyait pas le pillage de la nature et la rupture dans le métabolisme entre la société et la nature, comme nous l’avons montré dans les premières parties de ce texte. La différence est que, pour Marx, la rareté est produite socialement au cours de l’histoire et que les soi-disant « limites naturelles » sont un rapport social au sein de la nature et non une nécessité imposée de l’extérieur.
Le fait qu’au sein du « mouvement écologique », nombre de théoriciens, même marxistes, font appel à des idées malthusiennes peut s’expliquer par le pillage excessif de la nature dans les pays du capitalisme d’État qui se référaient à la théorie de Marx. Cependant, sans se poser de question, ils ont fini par accepter et par adopter l’argument capitaliste des « limites naturelles » et la « loi naturelle de la population ». Une véritable critique de l’écologie du capitalisme devrait avoir un autre point de départ. David Harvey avance que ce que la société considère comme une « ressource naturelle » nous parvient à travers « une évaluation économique, technique et culturelle d’éléments et de processus dans la nature que l’on peut employer à satisfaire des buts et à remplir des objectifs sociaux par le biais de pratiques spécifiques concrètes »[55]. Par conséquent, la définition même de ce qu’est une « ressource naturelle » implique des processus sociaux spécifiques :
- L’évaluation des éléments et des processus naturels correspond toujours à un état des connaissances, à une conception et à une communication particulières qui varient historiquement et géographiquement.
- Les dimensions culturelles, économiques et techniques d’une telle évaluation sont susceptibles de changer rapidement et cela confère une grande fluidité à définition des ressources naturelles.
- Les objectifs et buts sociaux varient considérablement selon les sujets qui les expriment et correspondent à la manière dont les désirs humains sont institutionnalisés, exprimés et organisés.
- Les éléments et les processus de la nature ne changent pas seulement en raison des processus naturels permanents du changement, mais aussi parce que les pratiques sociales sont toujours des activités qui transforment la nature et la société, avec toutes sortes de conséquences intentionnelles ou non. Ce qui existe dans la nature est dans un état de constante transformation.
En appeler à poser des limites à la population et aux ressources naturelles sans évoquer la nécessité d’abolir les rapports de production et les rapports sociaux capitalistes revient essentiellement à accepter l’état de choses actuel[56]. Cette position n’indique rien d’autre que le fait qu’il n’existe ni volonté ni capacité de faire évoluer l’état de nos connaissances, de transformer radicalement nos buts sociaux, nos modes de vie culturels et la configuration technologique de la production. Et il n’exprime pas non plus, à un niveau beaucoup plus avancé, la volonté d’abolir l’économie en tant que sphère séparée, tenant au contraire pour acquis que nous ne sommes pas collectivement assez puissants pour changer les pratiques sociales dominantes. En d’autres termes, une transformation révolutionnaire de la société et la transformation correspondante de son rapport à la nature non-humaine ne peut se concevoir dans le contexte de la théorie de la « surpopulation » et des « limites naturelles ». Ainsi que D. Harvey le remarque de façon pertinente dans le même ouvrage : « tout débat sur l’éco-pénurie, sur les limites naturelles, sur la surpopulation, et sur la durabilité est un débat sur la préservation d’un ordre social particulier, plutôt qu’un débat sur la sauvegarde de la nature en soi »[57].
Dans la conjoncture mondiale actuelle, alors que la stratégie capitaliste dominante en Europe est une politique d’austérité et de dévalorisation du capital, la théorie de la « décroissance » peut fort bien servir d’idéologie pour légitimer la politique de dévalorisation et de gestion de la population mondiale excédentaire.
7 – En guise d’épilogue.
Le capital n’est pas seulement un rapport d’exploitation et de domination de classe mais c’est également un rapport d’aliénation de la société et de la nature dans laquelle tant les producteurs de la richesse sociale que la nature non-humaine en tant que force productive autonome sont transformés en objets qu’il domine et pille. Toutefois, ce processus de subsomption de la nature et du travail dans le capital est conflictuel et contradictoire. D’une part, la subsomption du travail dans le capital contient une antithèse réelle : tant que le capitalisme existera les prolétaires seront contraints de vendre leur force de travail au capital ; leur reproduction est basée sur leur objectivation en tant que capital variable. En même temps, l’objectivation du travail est une expérience de dépossession et d’aliénation. Cette antithèse est le fondement d’une lutte de classe qui peut évoluer vers une pratique radicale de refus et de contestation du capital, déchirant le voile du fétichisme et révélant son contenu, à savoir un rapport de domination de classe. « C’est à ce moment que nous réalisons que la puissance ‘objective ’du capital provient de notre travail et qu’ainsi le capital n’est pas omnipotent et que nous pouvons le démanteler. Cette valeur ne peut demeurer ‘objective’ si nous nous conformons aux lois de l’échange et au travail salarié »[58]. D’autre part, la nature « réagit » contre le processus de sa subsomption dans le capital en provoquant des phénomènes tels que le réchauffement climatique, l’apparition de mauvaises herbes super-résistantes, le ralentissement de la productivité agricole, et ainsi de suite, qui tiennent lieu de limites à l’accumulation capitaliste. Et si le capital postule que chaque limite que dressent le travail et la nature sont des barrières qu’il outrepasse idéalement, cela ne signifie absolument pas qu’il domine réellement la situation.
Face à la peur que l’on entretient face aux symptômes de la crise écologique capitaliste, nous devons réagir en nous occupant de la « maladie » elle-même. « Aujourd’hui la peur est partout, on n’en sortira qu’en se confiant à nos propres forces, à notre capacité à détruire toute aliénation existante, et toute image du pouvoir qui nous a échappé. » Guy Debord, La planète malade.
Antithesi, 28.8.2017
[1] J. Rockstrӧm et al., « A safe operating space for humanity », Nature 461(24), 2009.
[2] La production agricole à forte intensité de capital a contribué à 80% de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre entre 1997 et 2002. (Voir le livre de J. W. Moore, Capitalism in the Web of Life : Ecology and the Accumulation of Capital, Verso, 2015.
[3] Voir J. W. Moore, opus cité.
[4] E. Apostolopoulou, « Critique de l’idéologie dominante du développement portant sur la relation entre la société et la nature », Outopia 91, 2010 (en grec).
[5] A. Vlachou, Nature and Value Theory, Science and Society 66(2), 2002.
[6] Le Capital, volume I, Bibliothèque de la Pléiade, p.727.
[7] Œuvres choisies, volume II, Gallimard, p.283.
[8] En fait, dans la mesure où les conditions naturelles et les ressources naturelles ne sont pas des marchandises produites par le travail humain, elles n’ont aucune valeur bien qu’elles puissent être des valeurs d’usage. Cette clarification est indispensable ici car le concept de dévalorisation de la nature pourrait être interprété à tort comme la perte d’une substance a priori inhérente dans les valeurs d’usage naturelles, erreur que commet une partie du courant marxiste du féminisme en ce qui concerne le travail domestique. Comme nous le démontrerons dans les pages suivantes, la non-valeur de la nature et du travail domestique féminin joue cependant un rôle très important dans la dépréciation du capital constant et variable et, par conséquent, dans l’accroissement de la rentabilité capitaliste.
[9] Karl Marx, Le Capital, volume I – La marchandise I, Bibliothèque de la Pléiade, pp.584-585.
[10]Karl Marx, Grundrisse, chapitre de l’argent, éditions 10/18, p.138. NdT : Outre la difficulté de trouver les Grundrisse à l’heure actuelle s’ajoute celle de faire coïncider le texte anglais traduit de l’allemand et le texte français également traduit de l’allemand, ce qui peut donner des traductions très éloignées, parfois difficilement comparables et assimilables.
[11] David Harvey, The Limits to Capital, Verso, 1982.
[12] J. W. Moore, « Transcending the metabolic rift: a theory of crises in the capitalist world-ecology », The Journal of Peasant Studies 38(1), 2011.
[13] Karl Marx, Théories sur la plus-value, tome I, Éditions Sociales, page 92.
[14] Karl Marx, Theories of Surplus Values, Part III, Progress Publishers, 1971, p.131. NdT: je n’ai pas réussi à trouver le tome 2 de cet ouvrage où se situe probablement cette citation, la traduction est donc de moi.
[15] Karl Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, Textes et commentaires, Vrin éditeur, pp. 121,122 et 124.
[16] Karl Marx, Grundrisse, chapitre 4 du capital, éditions 10/18, p.270.
[17] Karl Marx, Grundrisse, Vintage Books, p.497. La traduction est de moi.
[18] Karl Marx, Grundrisse, ch. Du capital, éditions 10/18, p.215.
[19] Karl Marx, Le Capital volume III, Bibliothèque de la Pléiade (volume 2), pp. 1423-1424.
[20] Karl Marx, Le Capital Volume I, Bibliothèque de la Pléiade, pp. 997,998, 999.
[21] Karl Marx, Le Capital, Volume I, Bibliothèque de La Pléiade, p.800.
[22] Karl Marx, Le Capital volume III, Bibliothèque de la Pléiade (vol. 2) pp.1487-1488.
[23] NdT : Système d’intensification du riz ou SIR : combinaison de méthodes visant à augmenter le rendement tout en réduisant les apports d’intrants agricoles.
[24] Voir J. W. Moore, opus cité. De toute façon, il est risqué de présenter des méthodes de production particulières et des innovations comme des « solutions » susceptibles de mettre fin au pillage de la terre par le capital, car il est possible en fin de compte d’incorporer ces « solutions » dans le système général de l’exploitation capitaliste du travail et de la nature sans, pour l’essentiel, en changer la nature. En outre, cela s’est déjà produit avec les prétendues sources d’énergie renouvelables (les éoliennes, par exemple). Non seulement ces technologies n’ont entraîné aucune réduction des gaz à effet de serre, mais elles ont également généré de nouveaux problèmes comme, par exemple, la destruction des écosystèmes locaux là où elles s’installaient et la mort de milliers d’oiseaux menacés d’extinction.
[25] Karl Marx, Le Capital volume III, Bibliothèque de la Pléiade (vol.2), pp. 1385-1386. C’est nous qui soulignons.
[26] Karl Marx, Le Capital volume I, ch. VIII, Bibliothèque de la Pléiade, page 736.
[27] Karl Marx, Le Capital I, ch. XV, Bibliothèque de la Pléiade, page 931.
[28] Karl Marx, Le Capital III, ch. XXI, Bibliothèque de la Pléiade, page 1313.
[29] En outre, le capital s’approprie gratuitement les forces productives résultant de la coopération, de la division du travail, du progrès scientifique et technologique. « De même que l’élasticité de la force de travail, le progrès incessant de la science et de la technique doue donc le capital d’une puissance d’expansion, indépendante, dans certaines limites, de la grandeur des richesses acquises dont il se compose. Sans doute, les progrès de la puissance productive du travail qui s’accomplissent sans le concours du capital déjà en fonction, mais dont il profite dès qu’il fait peau neuve, le déprécient aussi plus ou moins durant l’intervalle où il continue de fonctionner sous son ancienne forme. » (Karl Marx, Le Capital I, ch. XXIV, Bibliothèque de la Pléiade, page 1112.) En outre, le capital s’approprie gratuitement les forces productives du travail précédent désormais objectivé dans les moyens de travail, dans la même proportion qu’elles sont utilisées intégralement mais consommées seulement en partie, c’est-à-dire dans la mesure où elles servent d’agents dans la formation des produits sans ajouter de valeur à ces produits. (Voir Karl Marx, Le Capital I, Bibliothèque de la Pléiade, page 1115.)
[30] Lorsque les valeurs d’usage naturelles n’accroissent pas la productivité du travail, comme c’est par exemple le cas d’un lot de terrain sur lequel une usine est construite, le prix de la terre résulte du monopole des propriétaires qui disposent du terrain en question, titre légal qui leur permet, comme Marx le décrit de manière très expressive dans le volume III du Capital, d’arracher un « certain impôt monétaire » aux industriels capitalistes qui est pris sur le montant total de la plus-value produite.
[31] Karl Marx, Le Capital III, ch. XXI, Bibliothèque de la Pléiade (vol.2), page 1314.
[32] Karl Marx, Le Capital III, ch. XXI, Bibliothèque de la Pléiade (vol.2), page 1316.
[33] Karl Marx, Le Capital III, ch.XXI, Bibliothèque de la Pléiade (vol.2), pp. 1357-58.
[34] P. Psarreas, « Capitalisme, crise écologique, écologie et perspective éco-socialiste », Theseis 105, 2008 (en grec).
[35] J. W. Forrester, World Dynamics, Wright-Allen Press, 1971.
[36] D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, The Limits to Growth, Pan Books, 1974. (NdT: rapport publié en 1973 aux éditions Fayard sous le titre Halte à la croissance?, et mieux connu sous le nom de rapport Meadows). Le Club de Rome est un think tank international dont les membres incluent ceux de familles royales, des économistes et des scientifiques « éminents », des membres du personnel politique de divers États capitalistes, des propriétaires de grosses entreprises capitalistes, etc.
[37] Ce passage est tiré d’un article de Maria Markantonatou « From The Limits to Growth to « Degrowth » : Discourses of Critique of Growth in the Crises of the 1970s and 2008”, Working Paper 05/2013, DFG – Kollegforscherinnnengruppe Postwachstumgesellschaften.
[38] Nous étudierons le rapport de ces idéologies avec le discours « décroissant » actuel dans les pages suivantes.
[39] Voir P. Psarreas, opus cité. Ce rapport est également connu en France sous le nom de rapport Brundtland (NdT).
[40] Il est vraiment incroyable que la définition du « développement durable » que donne ce think tank capitaliste soit pour l’essentiel un détournement de la position correspondante de Marx que nous avons citée (voir note 25). Bien entendu, la critique de la propriété capitaliste en a été totalement éliminée.
[41] Voir P. Psarreas, opus cité.
[42] Nous avons démontré dans les pages précédentes pourquoi la nature non-humaine n’a aucune valeur dans le capitalisme, ainsi que la manière dont les ressources sont monopolisées dans le cadre des rapports de propriété capitalistes qui leur attribue un prix.
[43] S. Bӧhm, M. C. Misoczky, S. Moog, “Greening Capitalism? A Marxist Critique of Carbon Markets”, Organisation Studies 33(11), 2012.
[44] Même des technocrates des Nations Unies ont qualifié la production de biocarburants de « crime contre l’humanité » parce qu’elle contribue à la crise alimentaire mondiale (voir P. Psarreas, op.cit).
[45] E. Apostolopoulou, op.cit. Dans cet article, Apostolopoulou parle de la toute première « région protégée » du monde, le Parc National du Yellowstone aux États-Unis, créé en 1872. Sa création visait à expulser la population indigène et entraîna la mort de centaines d’Amérindiens.
[46] Les données et le tableau que nous présentons ici provient de l’article de J. Martinez-Allier, L. Temper, D. Del Bene et A. S. Scheidel, « Is there a global environmental justice movement ? », The Journal of Peasant Studies, 43 (3), 2016, sauf contre-indication.
[47] Ces processus d’accumulation primitive bénéficient souvent de la division sexuée du travail déjà existante et des rapports de propriété patriarcaux pour déposséder autoritairement les communautés de leurs moyens de subsistance. Par exemple, dans les communautés indigènes bantoues qui vivent en Afrique, les femmes étaient majoritairement responsables de la récolte des fruits, de la fabrication des médicaments et de la cuisine ; les hommes s’occupaient de la chasse et de la culture. Les hommes ont des droits exclusifs sur l’utilisation des outils en fer et sur le défrichage de la forêt pour la culture. Avec l’introduction de la sylviculture marchande capitaliste, il est plus probable que les hommes acceptent de couper les arbres en échange d’argent, tandis que les femmes opposeront sans doute plus de résistance parce qu’elles perdent l’accès aux ressources nécessaires à la fabrication des médicaments et de la nourriture et en même temps ne gagnent pas d’argent grâce à la vente du bois puisque les hommes ont la « propriété » exclusive des arbres. C’est la raison pour laquelle les femmes s’impliquent beaucoup plus dans les mobilisations contre l’exploitation forestière et la déforestation capitalistes. Voir S. Dauthey, J.-F. Gerber, « Logging conflicts in Southern Cameroon: A feminist ecological economics perspective”, Ecological Economics 70 (2), 2010.
[48] F. Schneider, G. Kallis et J. Martinez-Allier, « Crisis or opportunity ? », Journal of Cleaner Production 18, 2010. Cité par M. Markantonatou, op. cit.
[49] Serge Latouche, Farewell to Growth, Polity Press, 2009 ; il s’agit de la traduction du en langue anglaise du Petit traité de décroissance sereine, publié chez Mille et Une Nuits en 2007 (NdT). Cité par Markantonatou « Growth Critique in the 1970s Crisis and Today : Malthusianism, Social Mechanics and Labor Discipline”, New Political Science 38 (1), 2017.
[50] S. Latouche, « The Globe downshifted », Le Monde Diplomatique, janvier 2006. (Ndt) : La traduction est de moi car je n’ai pas réussi à trouver à quel article correspondait celui-ci, ce n’est en tout cas pas à un article de janvier 2016 dans la version française de ce périodique.
[51] C. Taïbo, En defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie , Los Libres de la CATARATA, 2009.
[52] ibid
[53] Ce passage est basé sur le chapitre « Ecoscarcity and natural limits : The Malthusian tradition » du livre de David Harvey, Justice, Nature and the Geography of Difference, Blackwell, 1996. NdT : livre qui n’a pas été traduit en français, à ma connaissance.
[54] Karl Marx, Le Capital I, XXV, 3, Bibliothèque de la Pléiade, pp. 1146 et 1148. L’analyse que fait Marx de la surpopulation relative dans Le Capital est très riche mais, parce que nous devons être brefs, nous ne pouvons pas l’étudier ici.
[55] D. Harvey, op. cit., p.147.
[56] Certes, dans le cadre de rapports sociaux communistes, il existera des limites écologiques. Dans ce contexte, le processus révolutionnaire implique nécessairement la transformation des besoins sociaux et de la manière dont ils sont satisfaits, c’est-à-dire de ce que nous produisons et consommons, de la manière dont nous produisons, de telle sorte que nous réussissions à surmonter l’aliénation de la société et de la nature.
[57] D. Harvey, op.cit., p.148. Dans le même chapitre, D. Harvey signale, avec justesse, l’usage que l’on pourrait faire de la théorie des limites absolues aux ressources naturelles et à la population. « Chaque fois qu’une théorie de la surpopulation s’empare d’une société gouvernée par une classe dominante, alors les classes subordonnées subissent invariablement quelque forme de répression sociale, économique, politique, ou matérielle. » (p.149).
[58] Revue Aufheben : « Moishe Postone’s Time, labour and social domination – capital beyond class struggle ? » Aufheben 15, 2007.